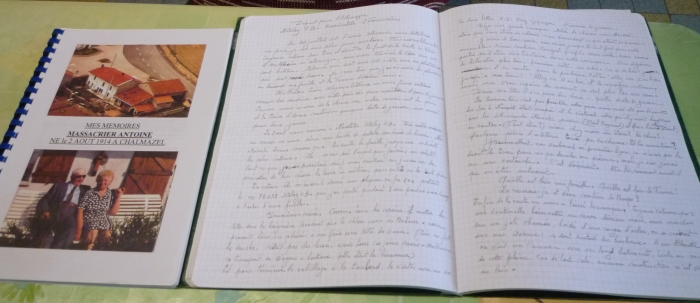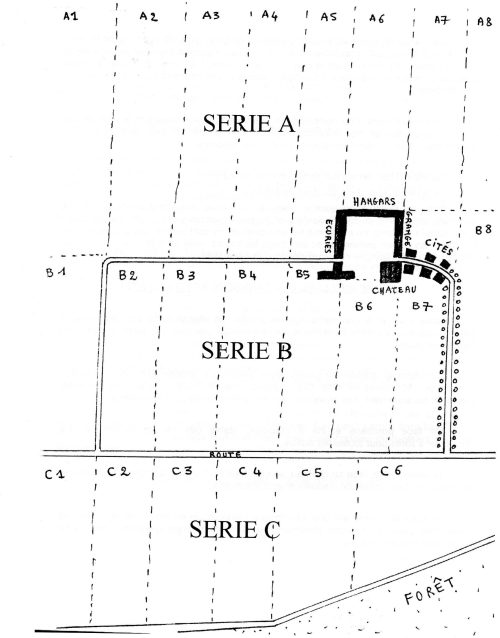Nous arrivons à une petite
montée
bordée de chaque
côté
par des maisons
basses ; ce sont les cités ouvrières de la ferme,
deux ménages par maison, puis c'est
l'entrée du quartier.
A gauche, le château du patron avec perron, sa
véranda avec vue sur tout le
quartier de 150
mètres de côté.
Côté gauche après le château, ce sont les
garages,
greniers et baraquements des prisonniers et
chambre spéciale
pour la sentinelle.
En face, porcherie écurie à chevaux, étable des
vaches laitières et les
stabulations libres pour toutes les autres.
Troisième côté, face au château, se sont tous les
hangars à chariots et machines agricoles, tracteur, atelier de
menuiserie et charronnerie.
Le quatrième côté est une très longue
construction en bois dont la toiture est
assez plate,
poutres, chevrons, planchers recouverts d'un carton spécial
où une couche
de goudron l'imperméabilise.
Cette couche de goudron renouvelée tous les deux
ans est vraiment efficace. Sous cette toiture longue, c'était la
grange, une série de travées servant à engranger la récolte,
gerbes de blé, seigle, orge, avoine. Chaque travée avait ses
deux grandes portes, entrée et sortie de l'autre côté, avec sa
prise de force entre chaque entrée pour le battage.
La batteuse, lorsqu'une travée était battue,
avançait jusqu'à l'autre par le milieu de la grange et ainsi de
suite sans passer dehors.
NOTRE ARRIVEE A LA FERME.
Drôle d'impression.
C'était vers les cinq heures de l'après-midi, on
nous emmène directement à notre logement ; salle à manger avec
une table, grandeur pour 12 pas trop gros, avec possibilité de
circuler autour, mais sans doubler et un poêle rond à charbon.
Chambre à coucher spéciale. A même le plancher,
une planche sur chant le long du couloir pour arrêter la paille,
une poutre le long du mur servant d'oreiller, au milieu un peu
de paille et voilà la place de six dormeurs couchés côte à côte.
Pour les six autres, c'est exactement le même procédé, avec un
plancher à 1m20 au-dessus.
La sentinelle a sa petite chambre à côté de la
notre. Il a un petit lit mais aussi de la paille.
Ce soir là, nous n'avons pas travaillé, nous
avons essayé de voir ce qui se passait ; des attelages de
chevaux de partout, des chars de gerbes qui arrivaient, les
voituriers debout sur ces chars de gerbes, leurs grands chapeaux
Mexicains faisant claquer le fouet, on aurait dit des fous à la
conquête de l'Ouest en Amérique.
Puis le soir on a gouté la tambouille, évidemment
pommes de terre en robe des champs, deux ou trois chacun, je ne
me souviens plus. Comme elles étaient bonnes, mais c'était
insuffisant.
Je ne peux pas décrire cette première nuit car je
ne m'en souviens pas, mais c'était mieux que sur le ciment à
Mulhouse.
A notre arrivée, nous étions aussi tous passés au
bureau du patron et subi un interrogatoire sur notre profession
et situation de famille.
Pour ce faire le patron avait fait venir son
beau-frère qui parlait un peu le Français, sans ça, pas un de
nous n'aurait compris un mot.
Le lendemain
matin à l'heure H tous réunis, le patron essaye par geste de
faire comprendre qui savait faucher, " Moi ".
Ils m'ont donné une faux et je suis parti faucher avec une bande
d'allemands, drôle d'emmanchage que cette faux mais tant pis,
tout s'est bien passé. Au casse-croûte de 9 h, j'avais mon petit
casse-croûte dans ma poche, il a vite été englouti.
Une dame qui avait apporté celui de son mari, un ancien qui
avait fait la guerre de 1914 m'a offert un morceau de
casse-croûte, (par vanité) je l'ai refusé, imbécile, moi qui
avait faim et c'était de bon cœur qu'elle me l'offrait.
Mes camarades étaient tous partis travailler avec une autre
équipe.
Il fallait aussi faire connaissance entre nous.
12 prisonniers presque de tous les coins de la France.
Quittet - Milo du Doubs, Francis - Boillet du Jura, Vallat
Conchy des Bouches-du-Rhône , Jules - Casseoucle de la Saône et
Loire, Chauler de la Marne, Mauri du Cantal, Légal de Paris et
moi de la Loire.
L'entente fut bonne dès le premier jour. Il le fallait car
intellectuel ou bougnat, nous étions tous à la même enseigne.
Nous étions tous surpris par le nombre d'ouvriers, le nombre de
chevaux de travail, l'importance de cette ferme. 50 ouvriers.
Dix familles avec leurs cités 1000 m2 de jardin et les 12 P.G.
Chaque matin, les équipes se formaient avec chacune, quelques
prisonniers, mais on se retrouvait tous pour la soupe, la
sentinelle suivait les équipes aux champs, toujours armée de son
fusil.
Le premier Dimanche, les 12 prisonniers au garde à vous furent
mis en rang devant le baraquement pendant qu'un gradé de l'armée
est venu spécialement nous lire le règlement concernant les
prisonniers de guerre.
Nous devions obéissance, politesse et maximum de travail. De
même que nous ne devions pas parler aux femmes et que sous aucun
prétexte elles ne devaient rentrer dans notre chambre, etc... De
plus, par un vote à bulletin secret nous devions élire un
responsable parmi nous. Celui qui sera élu sera le responsable
de tous ses camarades en toutes circonstances.
C'était plus qu'une charge, c'était une menace contre le
responsable. Personne n'était volontaire, surtout que pas plus
l'un que l'autre nous ne comprenions leur langage. Pourtant il
fallait le faire, et contre ma volonté ça tomba sur moi,
11 voix contre la mienne, je pris donc la décision d'apprendre
l'allemand et le plus vite possible.
Maria
m'envoya un petit dictionnaire Franco-Allemand qui me rendit de
grands services.
En peu de temps, je fus apte à faire face à la situation, à
défendre nos droits et à répondre du tac au tac.
J'étais Français et pas Allemand. Je suis fier de la façon dont
j'ai défendu mes camarades et moi-même.
Quelques jours après notre arrivée, on nous a donné une feuille
de papier qui faisait lettre et enveloppe. Pas besoin de dire
avec quel empressement nous l'avons remplie car depuis notre
capture le 19 Juin jamais nous n'avions donné de nos nouvelles.
J'ai reçu ma première lettre pour la Toussaint.
J'étais heureux de savoir tous les miens en bonne santé, mais
c'était avec un cœur bien gros que je pensais à ma dernière
permission et au moment pénible de notre dernier adieu !
Pourtant j'avais confiance. Ce fut à partir de ce moment que des
colis nous arrivèrent, je ne fus pas le dernier à recevoir le
mien. C'était bien la preuve que Maria pensait à moi. Ça
remontait le moral et ça nous permettait d'améliorer notre
festin, car les 12 camarades que nous étions, mettaient tous
leurs colis dans le même placard dont la sentinelle avait la
clef. Lorsque nous voulions faire un petit extra, nous n'avions
qu'à lui demander.
Mais un
jour, dans un semoir à engrais j'ai trouvé une clef, bien sûr
tout de suite nous l'avons essayée au placard, ça marchait,
alors souvent nous nous servions tout seul.
C'est
seulement le jour où il a fallu fuir devant les Russes que la
sentinelle m'a dit " Il faut prendre ce que vous avez dans le
placard " que j'ai répondu " C'est fait "
!
" Mais vous n'avez pas de clef " ," et celle-ci ! "
. Il a été
surpris de voir la mienne.
* Incroyables ces Français * Mis tout nus dans un tonneau ils en
ressortent habillés cinq minutes après.
Chacun de
nous est éberlué par l'importance de cette ferme, sur quatre
bornes dont on ne voit pas les bouts, aucun hameau ou village
alentour. Au loin, on aperçoit une autre agglomération, mais
sans en distinguer les ouvertures car leurs champs viennent
butter aux nôtres. Ce qui fait comprendre ces distances énormes
entre chaque ferme.
En quelques jours, tous ces cow-boys aux chapeaux mexicains ont
disparu, c'est nous qui prenons la place. Quelle différence,
tous travaillent sans bruit, dans un calme complet.
Pour 16
chevaux de travail, 3 Français et 1 allemand sont désignés.
Pour les
conduire et les soigner. Francis, Cassecuelle et moi chacun 4
chevaux.
Pour nous 3,
le réveil est à 5 H 30, une heure avant les autres, car il faut
les faire manger, les étriller, les harnacher, afin qu'à 7
Heures, ils soient au départ pour le travail (l'heure c'est
l'heure) et si la journée est de 10 ou 11 Heures, ils feront le
même compte que nous. Pour eux comme pour nous il y a un
règlement.
Chaque
matin, le voiturier passe au grenier avec son sac, 17 livres de
farine par jour et par cheval lui sont pesées par l'inspecteur
ou le contremaître. Cette farine mélangée à la paille de blé
hachée sera la nourriture quotidienne de ces bêtes. Souvent,
nous ne travaillons qu'avec deux, tout dépend du travail à
faire. Dans ce cas, d'autres voituriers sont requis, pas un
cheval ne reste au repos, il y a du travail pour tous.
Pour les
semailles, les labours se font avec 7 ou 8 attelages, l'un
derrière l'autre. C'est beau à voir surtout dans ces parcelles
si longues, que lorsque nous avons fait trois tours, inutile de
regarder l'heure, c'est midi.
Le tracteur fait aussi sa part, avec plusieurs socs.
Avant les semailles, il faut faire une semaine de battage pour
les semences et pour les animaux, le reste se battra en
décembre, janvier et février, minimum 50 journées.
Il y a aussi les pommes de terre, un sacré boulot, pendant trois
semaines, trois machines vont tourner autour de ces champs à
raison de 9 heures par jour, les enfants ne vont pas à l'école,
ils sont réquisitionnés pour le ramassage avec tous les parents
; même ceux qui ne travaillent pas d'habitude sont mobilisés et
répartis autour du champ. Chacun a une certaine longueur à
ramasser et à remplir des corbeilles qui sont mises à sa
disposition.
Trois ou
quatre chars espacés les uns des autres tournent aussi autour du
champ passant devant chaque ramasseur et vidant les corbeilles
pleines, l'inspecteur donne autant de jetons que de corbeilles
vidées. Les ramasseurs sont payés tant par corbeille et en fin
de récolte. Ces pommes de terre sont mises en silo, ou plutôt en
roules sur la terre le long du champ, bien placées pour passer
au trieur, calibreur.
50 à 60
hectares de pommes de terre, croyez que ça fait du travail.
Ainsi, pendant que les conducteurs de chevaux font les
semailles, les manuels à longueur de journée avec leurs fourches
se chargent du triage du calibrage des patates qui seront
livrées immédiatement en gare ou ailleurs.
Et les
pourries ou les gelées iront à la fabrique d'eau de vie. Pour ma
part, j'en ai livré des tonnes et des tonnes. C'étaient des
pommes de terre de sélection destinées à l'ensemencement de
l'année suivante. C'est vrai que c'était de la bonne qualité,
car à cette époque, pas besoin de sulfater, il n'y avait pas de
maladie, ni de doryphore en Poméranie.
Il y a aussi les choux-raves (rutabagas) une superficie moins
importante, une quinzaine d'hectares. La récolte se fait de la
façon suivante : Une équipe avec chacun sa pelle, coupe d'un
coup sec le collet des choux-raves sur pied et sur deux raies ;
ils sont une quinzaine à faire ça, quatre ou cinq autres avec
leurs fourches font des roules et des tas de ce feuillage.
Viennent ensuite les voituriers avec leurs chars à foin qui
chargent et emmènent ce feuillage et en font un silo dans un
endroit spécial près de la ferme, pendant que quatre ou cinq
chevaux tournent sans arrêt dessus pour tasser. Ensuite
l'arrachage se fait avec deux herses de cinq mètres attelées
avec trois chevaux chacune et qui tournent dans ce champ. Si le
terrain est sec, c'est du bon travail, bien arrachés, bien
propres car ils roulent sous la herse qui passe toujours deux
fois (aller retour).
Après c'est
le travail des voituriers qui plantent leur fourche dans chaque
choux-rave et hop dans le char. Comme pour les pommes de terre,
une roule est faite tout le long du champ. Les ouvriers
recouvriront cette roule de 30 ou 40 centimètres de terre, sans
mettre de paille. Tout l'hiver au fur et à mesure des besoins,
ces choux-raves seront rentrés, hachés au coupe racines et
mélangés aux blous de seigle pour la nourriture des vaches.
Souvent c'est une dure corvée que l'approvisionnement ; qu'il
neige, vente, ou gèle il faut y aller et avec la masse et les
coins pour casser cette épaisseur de terre qui les recouvre et
ceci tout l'hiver puisque vers Noël lorsque les premiers flocons
de neige arrivent c'est fini ce sera le gel et nous ne reverrons
plus la terre jusqu'au printemps.
Ceci est du à la proximité de la mer Baltique longue à refroidir
et longue à se réchauffer au printemps (l'air marin).
Je me souviens encore du jour de Noël 1940, il faisait un froid
terrible, nous n'étions pas assez habillés, Noël ou pas Noël,
nous les prisonniers nous avons travaillé toute la journée à
couvrir des silos de patates qui risquaient de geler tandis que
les civils sont restés au chaud.
Nous avons eu la preuve que le prisonnier est une spécialité à
part.
En Poméranie, dès que les premiers flocons de neige arrivent
c'est Noël à quelques jours près. Le premier travail est de
ranger les chars, il faut sortir et monter les traîneaux, ils
seront le moyen de transport jusqu'au début Avril, c'est-à-dire
le dégel.
Le 30
Décembre 1944,
après-midi le patron nous a envoyé labourer. Nous étions 5
attelages. 5 Français, en arrivant au champ, nous avons vu le
patron qui partait en voiture et justement il tombait quelques
flocons de neige. Après 4 ans de captivité j'étais rodé. Je
connaissais la situation.
J'ai dit à mes camarades
" inutile
d'atteler les charrues, lorsque la neige aura fondu la direction
ne se souviendra pas si nous avons labouré ou pas ".
Noël,
naissance du Christ, nous le célébrions à notre façon, selon nos
moyens, un petit arbre de Noël, quelques bouts du plus joli
papier que nous avions récupéré dans nos colis faisaient offices
de guirlandes. Un petit menu amélioré grâce à nos colis. Nous
pensions à notre famille en espérant chaque fois que ce serait
le dernier à passer derrière les barreaux et plein de tristesse
on chantait (Minuit Chrétien).
Personnellement je suis croyant et cette confiance m'aide
beaucoup à surmonter mes peines. Je savais qu'à force de
patience ce calvaire prendrait fin et que j'en sortirais vivant.
Je n'ai jamais eu peur. Je me suis surpris moi-même en voyant
avec quel aplomb j'ai toujours fait face aux difficultés qui se
sont présentées à moi pendant ma captivité.
Il faut bien dire : étant chef de commando, que la confiance
mise en moi par mes camarades était si forte que je me devais
d'en être digne. A ce sujet, je crois avoir été à la hauteur.
En dehors du
travail, notre vie en groupe n'était pas compliquée, chacun
avait de la volonté, c'était l'entente parfaite. Colis ou autre,
tout était partagé, pas un camarade n'a mangé un demi sucre de
plus que les autres.
Un camarade a reçu comme colis en tout et pour tout pendant sa
captivité 1 paquet de tabac et une savonnette, et bien ce
camarade d'une gentillesse peu commune se dévouait pour nous
cuisiner quelques extras pris dans nos colis, il méritait bien
sa part comme tous les autres.
(Je vous parlerai plus tard de sa fin tragique).
En dehors du travail, nous avions aussi à nous occuper de notre
hygiène, de notre propreté personnelle si nous ne voulions pas
voir apparaître des poux (là pas de problème) je coupais les
cheveux à toute l'équipe et Jules coupait les miens. Il y avait
la lessive, le raccommodage, et l'appartement à tenir propre.
Chaque semaine le plancher était lavé. Tous étaient volontaires.
Les loisirs étaient le tarot, la belote, les dames et un peu de
lecture.
Souvent à la
veillée, Quittet, notre plus instruit,
nous faisait faire des dictées, chacun essayait de faire le
moins de fautes possible.
Les Officiers Français en captivité ne travaillaient pas. Eux
aussi sans doute pour se distraire, avaient organisé un stage de
cours par correspondance.
Dans mon commando trois inscrits : Francis, Milo et moi.
Chaque semaine nous recevions notre paquet de devoirs à faire et
à renvoyer ensuite pour la correction. Ils nous revenaient
parfois avec une belle tartine dure à digérer. Je fus le seul à
tenir le coup.
Tout l'hiver
41-42 et en Juin,
je passais
mon certificat d'études en bonne position. Merci à mes
enseignants.
Tous les soirs, souvent jusqu'à 1 heure du matin durant l'hiver
j'en avais appris plus que pendant toute la scolarité de ma
jeunesse.
En Poméranie Orientale, l'hiver était dur pour les Français,
mais il l'était aussi pour les civils. Lorsque le vent se
calmait un peu, même avec 25 centimètres de neige et moins 12°,
souvent il fallait mener du fumier dans les champs.
Les voituriers comme moi n'étaient pas les plus malheureux car
ils restaient sur leurs traîneaux. Arrivés dans le champ ils
prenaient la fourche et jetaient le fumier dans la neige de
chaque côté du traîneau, aidés en cela par un autre collègue
tandis que les civils, en majorité des femmes, les pieds mal
chaussés dans la neige (car il n'y avait pas de bottes)
émiettaient ces grosses fourchées. Ce traîneau vidé, il en
arrivait un autre et l'opération durait toute la journée. Si
vraiment il y avait trop de neige, alors c'était un gros tas que
nous faisions au milieu des parcelles en prévision des
ensemencements du printemps.
C'était une avance pour la bonne saison. Avril, mai et Juin, il
y avait l'orge, l'avoine, les pommes de terre, les choux raves
et beaucoup d'engrais à semer. Les engrais il faut en parler. Je
me suis rendu compte de l'avance qu'ils avaient sur nous, dans
les Monts du Forez.
C'est vrai
que c'était une ferme où les ingénieurs agronomes venaient faire
leurs stages. Le terrain était étudié, analysé de façon à ce que
chaque parcelle, chaque année reçoive la dose d'engrais
correspondant à son bon rendement.
L'ensemencement était étudié de telle façon ; chaque série avait
son système de roulement où il était facile de savoir par
exemple ce qu'on sèmera dans dix ans dans la parcelle.
A-6 Série A ou B-4 dans la série B ou C-8 dans la série C.
Plusieurs
sortes d'engrais étaient nécessaires. Le mélange était fait à la
ferme, selon les parcelles et l'analyse du terrain.
Nous recevions l'engrais par le train en wagon entier.
Au sujet de l'engrais, pour nous, c'était aussi une occasion de
les aider à perdre la guerre.
*Une fois nous avons creusé un trou dans un champ et avons
enfoui 3 ou 4 sacs, comme ça il était plus rapidement semé et
nous savions qu'il ne ferait rien pousser *.
Chacun de nous avait son astuce pour leur faire des vacheries,
lorsqu'au printemps, nous repiquions les rutabagas. Je labourai
avec une machine à 3 raies. Comme pour ramasser les pommes de
terre, l'inspecteur mesurait une certaine longueur pour chaque
ouvrier chargé de repiquer. Pas d'outil. Une poignée de terre
prise sur la crête de la raie exactement à la place où devait
être mis le chou et reposée dessus le chou et tassée.
Spécialité Milo
: Il doublait le chou par le milieu, d'un côté de sa poignée
sortait le chou et de l'autre la racine (sans être vu...)
Spécialité Quittet
: C'était le ramassage des pommes de terre. Même longueur que
les autres, moitié moins de corbeilles pleines (secret) deux
pommes de terre dans la corbeille, deux enfoncées dans la terre
avec le pied. Il avait raison puisqu'on ne le payait pas à la
corbeille comme les civils mais 60 centimes les jours de
travail.
Spécialité Alex
: Un Belge assassin de poules. Un samedi, nous avons dit:
"Alex, demain tu nous fais manger une poule", "d'accord". Il
faisait le vacher et dans le local où il lavait ses bidons les
poules y étaient toujours fourrées. Il prit donc une pelle et
v'lan. une tête séparée du corps. L'affaire aurait réussi s'il
n'avait pas été vu. Il avait pourtant eu le temps de jeter le
cadavre dans la cave à pommes de terre qui se trouvait en face,
avant qu'une cuisinière vienne aux nouvelles. Il y avait du sang
partout sur le ciment. Affolée elle passe à la cave prendre des
pommes de terre et met la main sur la poule et l'emporte à la
cuisine. Lorsque je suis rentré de livraison les copains m'ont
appris le résultat.
Je suis allé immédiatement voir la direction en demandant ce qui
s'était passé. J'entendis donc toutes les plaintes et à mon tour
je fis comprendre que ces poules lui faisaient des saletés sur
ses bidons et que c'était un nerveux qui s'était laissé emporter
par la colère, que c'était un accident. La patronne me dit :
" Je voudrais bien vous croire Antoine ". Je sentais qu'il
restait un doute. C'était vrai car quelques jours plus tard un
sous officier Allemand rappliqua à la ferme et lorsqu'ils furent
dehors avec le patron, j'entendis hurler deux noms " Alex -
Anton "
Tous les deux, nous nous présentons devant nos juges.
Devant le
sous-of " Alex, combien tu m'as tué de poules ? "
" J'en ai
tué une chef ",
" tu n'en
as pas tué d'autres ? "
" non
chef "
Une petite réprimande. Terminé, je n'ai pas eu à intervenir.
Personnellement, il m'en était arrivé une drôle aussi qui aurait
pu avoir des conséquences graves.
Avec l'accord du patron nous avions fait un petit jardin
derrière notre baraque pour planter du tabac national.
Les poules venaient s'y mettre à l'ombre, pour nous c'était
tentant. C'était la seule viande que nous pouvions leur voler ;
alors un jour je prends un bâton et la première à ma portée
reçut la confirmation. K.O je la mis dans une musette et jetais
le tout au milieu du tabac.
Lorsque deux
minutes plus tard je revins tout fier, accompagné d'un copain,
voulant lui montrer mon exploit, la poule courait à travers,
avec ma musette au cou. Inutile de dire qu'un nouveau coup de
bâton mit le volatile hors d'état de nuire, il fut cette fois
enterré entre deux pieds de tabac en attendant la nuit pour la
rentrer car nous ne pouvions rien cacher dans la baraque, les
fouilles étaient trop fréquentes et imprévues. La cuisson se
faisait la nuit lorsque nous étions fermés à clef.
Pour le chauffage nous avions un poêle rond bois-charbon, nous
pouvions chauffer à volonté mais nous n'avions pas droit au bois
ni au charbon. Alors ! devinez la suite...
A la ferme
le charbon (en briquettes) arrivait en gros c'est-à-dire un
wagon entier, il était déposé dans un hangar fermé avec un
cadenas ; quand nous voulions du charbon, le soir avant qu'on
nous ferme à clef dans la chambre, nous partions à 3 avec une
corbeille.
Arrivés devant ces grandes portes, deux écartaient les deux
battants par le fond et le troisième se faufilait à l'intérieur
et le charbon sortait par briquettes pour remplir la corbeille
et même opération pour le copain, il sortait avec la même
méthode qu'il était entré. Un jour pourtant, j'ai eu du pot.
A l'écurie les voituriers, même l'hiver, finissaient leur
travail vers les neuf heures du soir, longtemps après la nuit
tombée. Ce jour le travail fini nous rentrions à la baraque
lorsque sur nous se braqua une lampe électrique, moi qui portait
ma capote sur le bras comme d'habitude.
Le porteur
de cette lampe, c'était le patron, voyant que je portais quelque
chose qui faisait quand même du volume, il croyait me prendre en
défaut, il m'a dit :
" Was
schleppen sie hie Anton ?" " Qu'est ce que
vous traînez là Anton ? "
"Das ist
nicht un pferd. Das ist mein mentel Chef " " C'est pas un
cheval, c'est mon manteau chef je m'en fous de vos chevaux".
Le lendemain
à la même heure et au même endroit nous l'avons encore rencontré
avec sa lampe, mais au lieu de la braquer sur nous, il éclairait
par terre, je l'avais mouché la veille.
Heureusement
pour moi car je portais une corbeille de charbon sur l'épaule.
Je l'aurais sans doute payé cher, il aurait fallu savoir comment
nous étions entrés dans ce dépôt. J'ai eu chaud.
Mais sauvé pour cette fois
C'était en 1943
; ça
n'allait pas très bien pour Francis, ça lui arrivait de
rouspéter pour rien et même souvent de casser quelque chose et
comme moi il encaissait mal une remontrance, si bien qu'un matin
que je n'étais pas là, il s'est disputé avec le patron et
lorsque je suis entré à midi il me dit :
" je veux
partir au camp, le vieux m'emmerde, je pars au camp, toi tu ne
sais rien ".
J'ai essayé de le retenir mais en vain.
" Ne
t'inquiètes pas, tu as le temps d'arriver au camp avant que le
patron s'aperçoive de ton départ " lui dis-je.
En effet le
camp était à 8 ou 9 kilomètres de notre ferme, nous reprenons le
travail à 2 h.
Il avait donc 2 heures et demi avant que la fugue soit
découverte .
L'après-midi, je devais hacher de la paille pour les chevaux, à
cause du mauvais temps, je n'avais pas attelé. Au bout d'un
moment, l'inspecteur me dit :
" Wo ist
Francis ? " Où est Francis ?"
" Je ne
sais pas "
- un quart
d'heure après il revient :
"Anton wo
ist Francis ? "
"
demandez au chef il le sait lui. "
Un moment
après, il revient encore et bien sûr pose la même question.
Ma réponse :
" je vous ai dit de demander au chef qu'il le savait lui "
(celui que j'ai toujours appelé chef c'était le
patron).
Ce fut fini
le patron ne m'en parla jamais.
Quelques
jours plus tard, je reçus une lettre de lui clandestinement bien
sûr. Il m'expliquait son aventure, pas toujours drôle. Au camp
il avait été puni 2 ou 3 jours, on voulait le renvoyer à la
ferme, il avait refusé, alors on l'avait envoyé dans un commando
ou le travail était dur.
Disciplinaire. Je lui écrivais aussi en l'appelant mon frère. Ma
lettre n'avait pas été contrôlée. Nous le regrettions, c'était
un bon copain.
Quelques
temps après son départ en allant chercher ce schlemp de la
fabrique d'eau de vie, je menais les bidons de lait jusqu'au
village voisin où le laitier les prenait. C'est partant de la
ferme à une petite descente devant les cités où le chemin est
bordé d'arbres qu'un de ces bidons s'est renversé, je monte sur
la marche pied pour le relever, mais c'est à ce moment que mes
chevaux se sont approchés trop près d'un arbre et j'ai été
coincé entre ma grosse tonne et cet arbre.
Je me suis
vu par terre K.O
j'ai eu la force de dire à mes chevaux de s'arrêter ; ce qu'ils
ont fait. Les civils m'ont emmené à la ferme et de là, à
l'hôpital du stalag (camp) où je suis resté une dizaine de
jours.
Ensuite je
devais aller en convalescence au camp, mais un quart d'heure
avant de sortir de l'hôpital je vois mes deux chevaux qui
attendent devant la porte ; j'ai cru qu'un autre accident était
arrivé à un copain. Je suis sorti en courant pour demander des
explications à ce jeune allemand qui m'a dit: " je viens te
chercher "
" comment
tu viens me chercher ? je dois aller en convalescence au camp,
je ne retourne pas à la ferme aujourd'hui "
Dans
moi-même, j'étais plus que content, le camp ne m'intéressait
pas, je n'y avais pas de copains, plus de colis et puis je ne
pouvais pas pirater pour remplir mon ventre. Seulement je
voulais laisser croire que je ne revenais pas par plaisir mais
forcé.
" et bien
" lui dis-je " je vais voir le docteur avant de partir "
ce que je fis.
Alors le docteur (un Polonais) me fit un papier :
* Erste woche ruhe . Zweite woche leicht arbeit. Une semaine
repos, deuxième semaine travail léger. *
Comme ça
j'étais fort.
J'étais tout
juste entré dans la baraque que le patron était déjà là
questionnant, demandant des nouvelles.
Je lui
montrais mon papier.
" ça ne
fait rien Anton si vous ne travaillez pas, pourvu que vous
soyez là, sans vous tout est désorienté, même vos camarades, ça
ne va plus ".
Moi qui ne
voulait pas lui faire voir que j'étais content de revenir, je
suis passé à l'attaque. Je lui demandais de quel droit il me
faisait venir avant ma convalescence et qui l'avait si bien
renseigné.
Il m'avoua
que c'était un sous-officier d'une commune voisine.
Alors moi je lui ai dit : " si je voulais, je vous ferai
enfermer en prison tous les deux, vous et votre unter-offizier
".
Tout s'arrêta là. Je pris donc ma semaine de repos, et forçais
le moins possible la deuxième semaine et puis tout rentra dans
l'ordre.
A tout ça,
il faut ajouter que Francis étant parti quelques temps avant, il
avait peur que je ne revienne pas.
Il savait très bien que ce départ m'avait refroidi.
Au
mois d'août 1944,
le patron prit trois semaines de vacances à Colberg, port de la
Baltique, à 60 Kilomètres de la ferme (Tanneberg). Nous avions
déjà un inspecteur et un contre-maître, mais pour le remplacer
il prit un autre inspecteur, cet homme n'était pas mauvais,
pourtant il voulait faire voir qu'il n'était pas venu pour rien
et pour marquer son autorité, il commença le premier jour en me
disant : " Anton, à partir d'aujourd'hui, tous les matins
vous nettoierez et sortirez le fumier des chevaux "
Inutile de
dire que ça ne me plaisait qu'à moitié, car c'était un travail
supplémentaire. Pris sur le vif, ma réponse ne se fit pas
attendre.
" Chef,
il y a 4 ans que nous sommes ici, nous ne l'avons jamais fait.
C'est pas que je ne veux pas, c'est que nous n'avons pas le
temps, ou alors, qu'on nous donne que 3 chevaux à soigner au
lieu de 4 et nous le ferons. "
Le lendemain
à 5 H 30 l'ancien inspecteur arrivait en même temps que nous aux
écuries et s'asseyait sur une botte de paille. Moi, flairant le
piège, je dis à mes gars.
" Ce
citoyen n'est pas là pour des prunes, il veut contrôler le temps
que nous mettons à faire notre travail, arrangez-vous pour en
avoir jusqu'à 6 H 45 de façon à ce que nous ayons juste le temps
de boire le café et nous débarbouiller avant de partir au
travail ".
Nous avions
gagné, le lendemain Milo, après avoir mené le lait au village
voisin fut chargé du nettoyage à notre place et les trois
semaines se passèrent dans les meilleures conditions avec notre
nouvel inspecteur.
Puis les vacances terminées, le patron fit son apparition aux
écuries à 7 Heures et après les politesses d'usage :
" Anton,
tous les matins, il faudra sortir le fumier des chevaux "
J'avais dis
non à l'autre inspecteur, j'allais pas dire oui au patron. Ma
réponse reprit exactement les mêmes mots que ceux que j'avais
dit à l'inspecteur.
Pour la
première fois il proféra une menace !
" Anton, si vous ne le faites pas, je porte plainte auprès de
la compagnie "
Ma réplique
fut encore plus cinglante :
" Chef, faites ce que vous avez à faire, ça sera comme ça
! "
Ce fut tout pour ce jour. Je savais que c'était un bras de fer
entre nous deux.
J'attendais
le jour où je devrais faire face aux autorités militaires.
Quelques jours plus tard, je vis arriver un gradé chleu, je me
dis " attention, Toine ", " c'est sans doute pour toi
".
En effet,
après avoir conversé avec le patron, il entra dans notre
baraque.
Pas trop mal
tourné, il me dit " J'ai vu le patron, il est content de
vous, mais il voudrait.... (ce que j'ai déjà dit plus loin)
" et que Francis aille travailler ".
Je passais
donc à l'attaque et à la défense.
" Vous dites que le patron est content de ses P.G et bien
allez lui dire immédiatement que nous, nous ne sommes pas
contents de lui et que si cette comédie continue, je demande la
relève complète du commando.
De plus
Francis ira travailler lorsqu'il sera guéri et pas avant "
et je
continue : " vous venez ici pour nous dire que nous devons
travailler, d'accord, mais de nos intérêts vous connaissez quoi,
j'ai un gars qui fait le vacher, le patron devrait le payer
combien ? "
"Ich weis
nicht."
" Nous les voituriers qui commençons à 5 H 30 combien il
devrait nous payer ? "
" Ich
weis nicht " (je ne sais pas)
" Alors vous ne savez rien du tout ! "
Il est reparti con, comme il était, heureux de se sortir de là.
Mais à
l'écurie rien ne changea. Encore quelques jours et ce fut au
tour d'un officier de venir rendre visite. Bien sûr, je dus
encore me présenter, au garde-à-vous, salut réglementaire,
j'attendais quelques beuglées, et non, ce fut sur un ton amical
qu'il me dit :
"
Monsieur Weilland serait content si pendant ces grosses chaleurs
vous vouliez bien sortir le fumier des chevaux, après tout
rentrerait dans l'ordre ".
La réponse
ne traîna pas : " Qu'il commence par sortir celui qu'il y a,
il y en a haut comme ça ".
Demi tour
réglementaire et je repris le manche de la charrue que le patron
soit content ou pas, cela m'importait peu, j'avais dit non et
j'ai gagné mon bras de fer une fois de plus.
Ce ne fut
pas le seul.
A la ferme
il y avait un couple de vachers, plus un jeune homme qui fut
appelé par l'armée.
Milo dû le
remplacer. Ce vacher était un pur nazi et Milo devait subir ses
brimades et se taper le boulot, tandis que l'autre restait de
plus en plus chez lui et gueulait encore plus fort lorsqu'il
revenait, jusqu'au jour où Milo me dit " Antoine, je ne veux
plus travailler avec le vacher "
Il
m'expliqua pourquoi. " Bon " lui dis-je, " après la
soupe tu viendras avec moi, nous irons voir le patron."
Je demandais
donc si le patron pouvait m'accorder une entrevue ce que
j'obtins sans peine.
En compagnie
de Milo, j'abordais donc le sujet de notre visite. Pourquoi Milo
ne voulait plus travailler avec le vacher.
Le patron
nous laissa dire ce que nous avions à dire, puis à son tour il
me dit : " oui, le vacher quand il est là, il en fait pour
deux ".
"Mais,
c'est pas vrai chef, nous n'avons jamais vu un homme faire du
travail pour deux. Moi, je ne vous demande qu'une chose, pendant
une semaine contrôlez combien il passe d'heures aux écuries et
le travail qu'il fait."
Je n'ai jamais su combien il avait passé d'heures, ni le travail
qu'il avait fait pendant la semaine, mais ce que j'ai vu c'est
qu'au bout de la semaine le couple déménageait et Milo était
chef vacher.
Il continua
son travail avec le renfort que le patron lui envoya, jusqu'au
jour où un autre couple arriva et tout rentra dans l'ordre. Tous
étaient satisfaits.
DECLARATION DE GUERRE A LA RUSSIE
En Juin 1941,
lors de la déclaration de guerre à la Russie, d'après Hitler les
Allemands devaient redoubler d'efforts au travail en faisant
plus d'heures.
Le règlement qui s'appliquait aux allemands s'appliqua ! encore
davantage aux prisonniers (aux esclaves).
Un jour où
j'étais occupé à labourer, le patron vint à ma rencontre et
m'expliqua qu'à cause de la déclaration de guerre à la Russie,
il nous demandait de travailler une heure de plus par jour (nous
faisions déjà 10 H).
Ma langue
était déjà bien leste pour cracher de l'allemand, je répondis
que s'ils avaient déclaré la guerre à la Russie, c'était pas de
ma faute, que je n'avais rien à voir avec. Quand à l'heure
supplémentaire, il ne fallait pas y compter.
Et
j'ajoutais : " Chef, moi, ne me prenez pas de travers ou
alors vous me perdrez ".
Ce fut
terminé pour ce jour. Mais le lendemain avec bonne humeur, il
remit cela. Antoine, il faudra travailler une heure de plus, je
vous donnerai 10 centimes de plus (60 centimes pour la journée).
J'acceptais,
car je savais que je ne pouvais pas aller contre leur règlement.
Je devais toujours réfléchir, quand c'était mon droit, je ne
capitulais pas, mais si c'était impossible, je n'insistais pas.
La déclaration de guerre à la Russie fut la grande euphorie pour
les civils, sauf un ancien sous-off de la guerre 14-18.
Ce fut une
attaque éclaire accompagnée d'un discours d'Hitler qui leur
avait dit " Drei wochen Rusland caput " trois semaines et
la Russie est vaincue.
Je ne crois
pas que le patron ait été de cet avis. Il ne me l'a jamais dit,
mais le sous-officier lui, du premier au dernier jour m'avait
toujours dit : " Hitler ist feruct, wir aben nimal gesen
gegen gantz welt Deutchland ein krieg geniven " (Hitler
est fou, on a jamais vu l'Allemagne gagner une guerre contre le
monde entier).
Lui, c'était
le forgeron, le maréchal ferrant de la ferme, un homme voûté,
qui faisait presque pitié à voir. Parce qu'il ne voyait pas les
choses de la même façon que les autres, ceux-ci disaient que
c'était un communiste, pourtant personne ne l'avait vendu.
FIN
TRAGIQUE D'UN AMI POLONAIS
L'hiver
42-43
fut comme les autres, un hiver très froid avec beaucoup de
neige.
Un jour avec
mes chevaux ou traîneaux, j'étais allé livrer un chargement de
grains dans un moulin dont je connaissais bien le patron pour y
être souvent allé.
La main
d'œuvre était toute polonaise, des amis quoi. Comme il faisait
très froid, ils m'avaient invité à me chauffer près du brasero,
cinq minutes, tranquille à discuter, lorsque arrive un vieux
chleu, un hitlérien plutôt, qui prend immédiatement part à la
conversation.
Encore une
fois je sentais le piège, je mis donc ma langue dans ma poche,
j'eus raison.
Le vieux reprochait aux polonais qu'ils étaient bons à rien et
tout un tas de choses, alors que le plus âgé des polonais
répliquait que les Allemands perdraient la guerre, et qu'ils
seraient bien obligés de restituer la Poméranie et la Prusse
Orientale, qu'ils avaient volé à la Pologne et que la frontière
reviendrait à son ancienne limite.
Ça tournait
au vinaigre, l'homme d'Hitler ne l'entendait pas de cette
oreille.
Pourtant la
preuve est faite, le Polonais avait raison. Il était trop tôt
pour le dire.
Oui, mais
cette vieille crapule dénonce le jeune polonais. Le lendemain
tous les polonais des environs furent convoqués à venir assister
au spectacle près du moulin.
La consigne, ils devaient regarder l'objectif et non se
retourner. Il y avait le long du chemin près de ce moulin un
arbre (veme) dont une grosse branche traversait le chemin. Je
l'ai vu plus de cent fois cette branche. Quand apparu un
tracteur attelé à une remorque et le jeune polonais debout avec
la corde au cou, la remorque s'arrêta dessous cette branche qui
servit à attacher la corde et la remorque s'en alla...
Je ne vous
dis pas le reste. Non seulement ça suffit. C'est beaucoup trop.
Avec les Polonais, nous étions Amis, car ils étaient mal vus et
plus malmenés que nous par les Allemands. Comme les Arabes, avec
les gros colons en Algérie.
La comparaison est bonne.
Comme
cruauté, les Allemands n'étaient pas à une pendaison près, ni
aux coups de crosses de fusils.
La raison du plus fort est sans limites.
Dans une
autre ferme, dont les champs jouxtaient les nôtres, il y avait
une grande étendue de pommes de terre et pour l'arrachage, le
patron envoyait chercher au camp deux remorques de P.G Russes.
Une
soixantaine dont certains ne tenaient plus debout, tellement ils
étaient faibles.
Nous, nous
étions à 200 mètres quand nous en avons vu un tomber près d'un
silo.
Dès que la
sentinelle s'en est aperçu, il y est allé et nous l'avons vu
taper à grands coups de crosse.
Le Russe ne s'est pas levé et n'a plus bougé de la journée. Vous
pouvez deviner la suite.
Les Russes ont été beaucoup plus malheureux que nous.
La Russie ne
faisait pas partie de la convention de Genève, donc les P.G
n'avaient aucune loi pour les défendre. Pas de croix rouge, pas
de courrier, pas de colis.
Pour les chleus , les Russes, comme les Juifs, c'étaient des
bêtes noires qu'il fallait exterminer.
Après la
déclaration de guerre à la Russie, cette avance éclair,
26
000 PG
furent amenés au camp au début de l'hiver 41-42.
Au printemps
42,
déjà une grande partie étaient morts, malnutrition, les poux, le
typhus.
Nous, nous
avions été piqués contre le typhus, mais eux non.
Tout l'hiver
avec des remorques, ils empilaient les cadavres comme un char de
fagots et les conduisaient dans une fosse que d'autres camarades
creusaient à longueur de journée, et lorsque la journée était
finie, ceux qui avaient travaillé ne remontaient pas de la
fosse, certains étaient déjà morts mais les autres une balle à
chacun les faisaient passer de vie à trépas ; comme ça le secret
était bien gardé, pas un Russe ne peut dire mon camarade est
enterré là.
Mais lorsque
les Russes leur ont pris le dessus, les atrocités ont changé de
camp.
Tout en
fonçant vers Berlin ils prenaient leur revanche et leurs
plaisirs ! Ils leurs rendaient la monnaie de la pièce et
commettaient les mêmes horreurs.
Exemple : A Rutnau, en haute Silésie (Pologne) ou plusieurs
femmes religieuses ou non durent chacunes recevoir les fougues
de 15 à 25 Russes.
Ceci nous a
été raconté par les habitants de ce village pendant les deux
jours que nous y sommes restés en attendant que la voie soit
réparée pour continuer notre retour en France.
Pour les
Français, ce n'était pas la même chose, nous étions considérés
être des hommes, nous avions la convention de Genève, souvent
difficile à faire appliquer mais elle était là, elle nous
donnait droit au courrier à la Croix-Rouge, aux colis, et à nous
faire respecter.
De plus nous
n'étions plus en guerre et surtout Hitler aurait bien voulu que
la France collabore avec l'Allemagne.
Au début, dans mon commando, deux sentinelles avaient voulu se
servir de la crosse de leurs fusils, pour faire marcher les
Français plus vite. Ça ne leur avait pas réussi deux jours plus
tard, ils étaient partis sur le front Russe.
Notre patron avait été réglo. Pour nous, c'était encourageant de
savoir que s'il y avait des fous, il y avait aussi des hommes
dotés d'une conscience.
Pour le
travail, il fallait savoir quand bosser.
Certains moments, personne ne pouvait contrôler le résultat.
C'était le moment de tirer au flanc.
Ainsi, un
automne pendant une période vraiment sèche, nous devions défaire
un champ de trèfles au cultivateur, leur système de culture
étant de défricher la motte avant de l'enfouir à la charrue.
Nous
partions donc avec une douzaine de chevaux et nos cultivateurs
et pendant la moitié du temps nous tournions dans ce champ mais
même si nous montions sur nos cultivateurs, les dents ne
voulaient pas rentrer dans le sol... alors l'autre moitié du
temps et comme c'était en bordure de la propriété, il y avait
des arbres. Un gars montait un peu haut afin de voir au loin si
le patron ou un inspecteur venait dans notre direction.
Le cas
échéant, nous avions tout le temps de mettre tout en branle
avant qu'il puisse voir que nous étions arrêtés, ainsi passait
le temps, et lorsqu'à midi nous rentrions, pour arranger le
tout, je disais au patron :
" Là-bas, nous perdons notre temps, c'est tellement sec, les
cultivateurs n'y font rien " "Tanpis Anton, il faut
continuer."
Et le soir
nous remettions ça et dans les mêmes conditions et pendant une
semaine.
Un jour le
patron me demande : Anton, combien faut-il de temps pour
labourer la parcelle B.6 ?
Comme je me doutais que se seraient les copains qui la
laboureraient, j'ai mis un peu de marge.
Deux jours
plus tard, comme j'avais prévu, il a envoyé mes gars labourer.
Je ne sais pas s'il les a pris arrêtés, ou quoi, mais à midi
alors que je rentrai d'une livraison il me dit :
"Anton,
vous irez labourer ce soir, quand vous n'y êtes pas, vos
camarades ne font rien ".
Bien sur je
n'ai pas répondu, puisque je ne savais rien.
Mais l'après-midi en arrivant au champ quand j'ai vu ce qu'ils
avaient tourné, j'ai dit c'est bien les gars le patron n'est pas
raisonnable, ne vous inquiétez pas, nous en ferons moins ce
soir.
Pas de
chance, le patron est venu, il est resté tout l'après-midi à se
promener dans le champ.
Pas question
de faire une pause comme d'habitude, je menais la bande et je
trouvais que ça avançait trop, je tournais donc au ralenti,
autrement nous aurions terminé la parcelle. Ce que je ne voulais
pas.
Je pense que ça devait le ronger, mais il ne m'a pas dit
d'activer.
Quelques jours plus tard, nous étions dans une autre parcelle
avec tous nos attelages.
Quand le
patron, une fois de plus, a fait son apparition pendant tout
l'après-midi.
Bon, si c'est comme ça, mon caïd, tu en auras pour tes sous.
J'ai donc passé la première au ralenti et sans jamais nous
arrêter, nous avons tourné jusqu'à l'heure de dételer.
Alors le patron s'est approché et bien gentiment m'a dit :
" Vous voyez, Anton, si vous aviez roulé un peu plus vite,
vous finissiez la parcelle" .
Je lui dis :
" mais Chef, cette largeur qui reste, elle va jusqu'au
bout du champ. "
Ah bon !. Il
était bien resté tout l'après-midi, mais il n'avait pas vu le
bout lui !
Et puis, c'était en 44, le culot ne me manquait pas, je lui dit
:
" Vous ne
savez pas pourquoi c'est pas fini?"
" non "
" c'est
parce que vous êtes venu "
" c'est
pas vrai ",
" si
chef, chez nous en France, on nous fait confiance, nous n'avons
pas une sentinelle derrière le dos à longueur de journée ".
Ça n'alla
pas plus loin.
Il prit même
le manche de ma charrue pour finir la dernière raie avant de
dételer.
Il faut bien
que je parle de ce joli travail qui consiste à la plantation des
pommes de terre.
Après
préparation du terrain, enfouissement du fumier par un profond
labour, et un hersage sans fin pour ameublir la terre, je
conduisais une machine - largeur 6 raies - deux roues porteuses,
une à chaque extrémité. Entre ces deux roues, six autres roues
sans jante, mais simplement une palette au bout de chaque rayon
faisait le trou pour mettre la pomme de terre.
Résultat :
chaque roue intermédiaire, espacée, donnant la largeur de chaque
raie, et chaque rayon donnant la distance entre chaque pied de
pomme de terre : très joli travail.
Une douzaine
d'ouvriers, avec leurs sacs sur le ventre comme chez nous,
mettaient les pommes de terre (pour ce faire un char de pommes
de terre les suivait tout le long du champ et distribuait selon
la demande) c'était le rôle du voiturier, dès ce char vide un
autre prenait la place. Le travail était plus rapide que chez
nous. Les pommes de terre au lieu de rouler restaient dans les
trous.
Ensuite, une autre machine à 6 raies, tirée par trois chevaux
labourait les 6 raies à la fois (les comblait).
Ainsi, une
dizaine d'hectares étaient mis en place chaque jour.
Quelques
jours plus tard, c'était au tour de la herse. Puis à nouveau
labourage, hersage.
Le labourage
continuait jusqu'au début août et deux attelages avec leurs deux
machines à trois raies étaient chargés de ce travail. Aussi il
n'y avait jamais un brin d'herbe, le chiendent n'existait pas.
Quelle compétence, quelle différence avec notre système de
travail. Ces raies alignées à perte de vue les unes contre les
autres, on aurait dit des traits tirés au crayon, ça valait le
coup d'œil.
Nous avions
deux faucheuses américaines Bering les mêmes que chez nous, mais
avec un avant train pivotant, c'est-à-dire deux petites roues et
pas de timon, ce qui prouve que le terrain était plat, puisqu'il
n'y avait aucun moyen de freinage. Un simple palonnier pour
atteler les chevaux.
Pour les
chevaux, c'était moins fatigant sans flèche. L'inconvénient, il
n'y avait pas de système pour reculer.
Les deux premières années, nous fauchions avec les deux
machines. Un vieil allemand en conduisait une et moi l'autre.
Mais ce vieux perdait la vue et c'était trop dangereux pour lui
car il n'avait aucune prudence.
Les trois dernières années, je dus faucher tout seul j'étais
tranquille, je prenais deux chevaux le matin et les deux autres
le soir (10 ou 11 heures par jour et cela pendant 18 ou 20
jours).
C'étaient des prairies artificielles. 2 parcelles l'une contre
l'autre. Durée 2 ans.
Exemple :
une semée en 1940, l'autre en 1941. Chaque année la plus
ancienne était défrichée et une nouvelle était semée. Deux jours
de séchage et l'herbe était mise en roule. Arrivaient les
ouvriers avec leurs fourches qui en faisaient des tas (cuches)
deux ou trois jours après selon le temps. Les ouvriers
revenaient et tournaient cette fourchée sans dessus-dessous,
c'était tout et le seul travail pour sécher le foin.
Pour rentrer ce foin, c'était rapide, cinq ou six chars
roulaient. Deux équipes de deux pour charger, la première
commençait 10 minutes avant l'autre, ce qui permettait un
décalage soit pour rouler et arriver au monte charge l'un après
l'autre.
Ce monte charge était placé en dehors des bâtiments (fenière)
passait sur le toit et pointait son tapis roulant dans les
lucarnes selon la demande.
Pour les moissons, c'était le travail des conducteurs du
tracteur et de la lieuse. De jours ou de nuit, ils moissonnaient
tout.
Plus de 50
jours de battage. En cinq ans, j'ai moissonné seulement deux
jours avec la lieuse à chevaux, parce que ça pressait trop. Le
grain était trop mur.
Derrière la lieuse, c'était au tour des ouvriers à longueur de
journée. Ils plantaient ces gerbes par dix, comme chez nous.
Quand c'était fini de planter, un inspecteur comptait tous les
paquets de gerbes et déjà le compte rendu était fait, il
connaissait le résultat de la récolte.
Vous voyez,
ce n'est pas le travail qui me faisait souffrir, c'était surtout
l'absence des miens, cette affection qui me manquait.
Ces pauvres
cartes sur lesquelles on pouvait tout juste dire que tout allait
bien, sous peine, d'être puni ou censuré.
Nous avons souffert du froid car nous étions trop mal habillés.
Maria
m'avait envoyé un veston de travail. J'en avais eu grand soin,
j'étais fier avec ça. Un de nos problèmes, c'étaient les
chaussures.
En 1943,
je n'avais pas de chaussures lorsque nous avons planté les
pommes de terre.
J'ai marché
pieds nus tout l'été et jusqu'à fin octobre où j'ai reçu une
paire de sabots, faits par mon oncle Aimé Massacrier de Boibieux
et que Maria m'avait envoyés. Ces sabots m'allaient comme un
gant. J'étais content.
Ainsi avec ses hauts et ses bas, la vie continuait sans jamais
en voir la fin. Seul restait l'ESPOIR.
Le 30
Octobre 1944,
fut pour nous un jour de deuil. Un mauvais coup au moral.
Mort
tragique de JOJO.
Après l'arrachage et le ramassage des pommes de terre nous
passions la herse, elle découvrait les pommes de terre qui
étaient restées dans la terre. Alors une équipe d'une vingtaine
d'ouvriers prenait de front une largeur de terrain et ramassait
de nouveaux celles qui étaient découvertes.
C'est occupé
à ce travail que notre camarade Jojo reçut une balle en pleine
colonne vertébrale (balle provenant d'une forêt située non loin
de là). Les secours furent rapides. Transporté immédiatement à
l'Hôpital du camp où deux docteurs, un Belge et un Polonais
tentèrent l'opération, et d'après les renseignements qu'ils
donnèrent ; la balle étant au bout de sa course n'était pas
sortie et de ce fait avait mis tous les intestins en bouillie,
de là résultat impossible.
Notre Jojo
vécu deux jours dans cet état, sans jamais se plaindre. Quel
exemple.
En qualité
de Chef de commando je fus autorisé en compagnie de Quittet à
aller à son enterrement civil bien sûr, mais dans le respect, la
dignité avec un cercueil et non comme un Russe (dans le trou
comme une bête crevée). Un détachement Allemand lui rendant les
honneurs.
Par contre, j'avais voulu mettre un petit drapeau Français sur
son cercueil mais je fus sommé de le retirer rapidement.
C'était un
camarade que nous aimions beaucoup, il était marié sans enfant,
sans domicile fixe, pas un gitan, vivant à l'aventure avec sa
femme. Deux journées de travail lorsque ça se présentait. Un
déshérité de la vie, qui en quatre ans n'a reçu de sa famille ou
de la commune qu'un minuscule colis (je vous en ai déjà
parlé)-une savonnette et un paquet de tabac- J'avais protesté
auprès du maire de sa commune.
Qu'importe,
c'était notre dévoué camarade toujours prêt à aider les autres.
Sa disparition nous donna un terrible coup au moral. Ne pouvant
faire autre chose pour aider sa femme, chacun de nous versa le
peu d'argent que nous possédions et lui envoyâmes le total. Avec
nos condoléances attristées.
Après ce 30
Octobre 1944,
la vie monotone continua jusqu'au
5 Janvier
1945.
C'était un
dimanche où comme les autres jours j'étais allé à la fabrique
d'eau de vie, chercher ces résidus pour le bétail, qu'un
polonais m'apprit que l'armée Russe avait enfoncé la ligne
allemande à Breslau. Ordre fut donné aux allemands de se tenir
prêts pour l'évacuation. Ils durent faire des exercices
d'embarquement en prévision.
Pour nous c'était la joie, la libération en perspective deux
jours plus tard nous entendions le canon.
Janvier 1945
fut
extrêmement rigoureux, un froid terrible et beaucoup de neige.
Nous ne sortions qu'avec les traîneaux.
La route de
Neusttetur en direction Stettin était encombrée par toute la
population qui fuyait devant les Russes. Ça bouchonnait.
Souvent, ils n'avançaient que de deux kilomètres par jour avec
leurs chars à bœufs ou à chevaux. J'en ai vu plusieurs où ils
n'avaient plus qu'un cheval avec un bœuf d'un côté de la flèche,
l'autre était mort. Il n'était pas question de sortir de la
route, il y avait trop de neige. Ils étaient sur la route jours
et nuits sous ces étoiles qui brillaient sur la neige.
J'ai vu dans
ces chars, des personnes âgées toutes noires, gelées. Je ne sais
pas si elles étaient mortes ou vivantes. Une femme m'a dit :
"je viens de voir mourir gelé mon huitième enfant ",
d'autres me demandaient où elles pourraient trouver du lait pour
leurs enfants.
J'étais loin
d'avoir un cœur allemand, mais quand même c'était trop, beaucoup
trop.
Cinq ans
plus tôt, la France avait connu aussi cette débâcle. C'était
bien triste de voir ça. Mais rien de comparable, c'était en mai
et juin.
La
température n'était pas à 0°, mais à -20° ou -30° comme en
Janvier 1945.
Personnellement, avec mon traîneau j'allais tous les jours à la
fabrique d'eau de vie avec ma tonne chercher le schlemp pour les
vaches à 8 kilomètres. Il n'y avait pas de place pour moi sur la
route mais avec mon traîneau je passais à travers champs.
Vers le 15
Janvier,
ce fut notre tour d'avoir des soucis.
A minuit, la
patron accompagné d'un contre-maître entra dans ma chambre,
"Anton", il faut vous lever, nous avons reçu l'ordre de partir".
Moi qui
avait déjà vu depuis 3 semaines la vie de ces martyrs sur la
route, je n'étais pas chaud pour partir. Je lui dis: " vous
voulez aller où ? "
"
n'importe où que vous alliez les Russes vous rattraperont" .
"
Peut-être Anton, mais nous avons reçu l'ordre, prenez un
camarade, 4 chevaux et le chasse-neige que vous chargerez de
cailloux et vous ferez la trace jusqu'à la grande route (3 Km)."
A une heure
du matin avec Milo, nous partîmes avec notre chasse-neige chargé
dans cette neige, la nuit était claire, pas un nuage, des
étoiles qui brillaient sur cette nappe blanche.
Une
température de -20°. La neige étant trop tassée et gelée, le
chasse-neige avait glissé dessus.
Je dis au
Patron " Chef, vous voulez partir c'est impossible, la neige
est trop dure, le chasse-neige n'a rien fait ".
" Il faut
essayer quand même " me dit-il.
8 Chars
furent attelés. Chaque voiturier avait ordre, l'un de charger le
strict nécessaire dans cette famille et les autres dans les
autres familles et à 9 Heures direction la sortie. Comme à
l'habitude j'étais à l'avant poste, nous n'avions pas fait 100
mètres que mon char était planté dans une congère, et moi
j'étais tranquillement assis sur la banquette, c'était un moment
joli à voir, car tous les civils avec leurs pelles, de la neige
plus haut que le genou, dégageaient les roues.
Quand ils
avaient fait un peu la trace, ils me disaient " essayez voir
Anton, allez hi " ça démarrait mais deux mètres plus loin
c'était à nouveau bloqué et les pelleteurs recommençaient, et
ainsi de suite tous les deux ou trois mètres.
En deux
heures, nous n'avions pas fait cent mètres, et de temps en
temps, je disais au patron " vous voyez bien chef, nous ne
serons pas arrivés à la grande route que les chevaux seront
crevés ".
J'avoue que
je ne m'étais pas mouillé les pieds pour faire la trace, car
j'étais resté tranquille sur mon char.
Je n'avais pas de fouet non plus ce jour-là. Il faut le dire, je
n'avais pas du tout envie de crever gelé sur la route. Vers les
11 Heures, le patron donna d'ordre de faire demi-tour.
Jusqu'au début Février, nous avons donc continué le battage.
Pendant ce temps la neige fondait un peu, la route, après le
repli des fuyards commençait à être dégagée de tous ces
véhicules. Par contre cette neige tassée formait une épaisseur
de vingt centimètres de glace sur la chaussée.
Tous les
chevaux furent cramponnés pour aller sur la glace, et de nouveau
nous partîmes. Personnellement, j'emmenais le char du patron.
Huit kilomètres plus loin, il voulut rentrer dans une mairie.
Pendant ce temps il arriva une averse, nous étions tous mouillés
et les chars qui n'étaient pas couverts, les paillasses comme
tout le reste pissait l'eau.
Tous ces
civils, en majorité des femmes, quelques bébés, on commença à
gueuler, demandant où on les emmenait, qu'elles ne voulaient pas
mourir sur la route, qu'elles voulaient retourner à Tannberg (la
ferme).
Je sentais
venir l'orage avec le patron.
Lorsqu'un
autre patron sortit de cette mairie et me demanda :
" C'est
le convoi Weilland ? " " Oui ".
Il a dit de
partir qu'il vous rattraperait...
Moi, j'étais
comme les civils, ça ne me disait rien de passer les nuits
dehors, je n'ai pas bougé.
Comme je
l'avais prévu, lorsque le patron est sorti, tous les civils se
sont mis contre lui, exigeant de retourner à la ferme. Après une
discussion longue et acharnée le patron dit :
" Tous
les voituriers qui emmènent les familles, rentrez à la ferme, et
nous avec Anton on s'en va ".
Alors là,
j'aurai donné gros pour avoir la photo.
Nous étions tous les deux plantés au milieu de la place de
Solnitze, nez contre nez.
Moi lui
disant qu'étant chef de commando, j'avais la responsabilité de
mes camarades, je refusais de les abandonner.
Lui me
disant " où je mourais, vous pouvez mourir aussi ",
" c'est
pas vrai, si vous avez déclaré la guerre aux Russes, vous n'avez
qu'à la faire, pour moi elle est finie, Attends moi Milo, je
fais demi tour avec vous, tout le monde à la maison ".
Pour la
deuxième fois nous avons donc fait demi tour.
Le lendemain
matin, à notre réveil, ses deux chevaux étaient déjà attelés à
la calèche et attendaient devant la véranda.
Après avoir donné ses ordres au contremaître, il partit chez sa
fille à Bad-Polztin (60 Km) sans nous adresser la parole. Je
commençais à voir que pour nous la situation devenait critique
après ces prises de gueules et ces refus d'obéir.
Dès qu'il fut parti, nous continuâmes les battages qui n'étaient
pas encore finis.
En
représailles aux civils, le patron avait donné ordre au
contremaître de ne pas leur donner de lait. Mais ces femmes qui
avaient des enfants en bas âge sont allées jusqu'à un poste de
l'armée faire part de leurs doléances. Nous n'étions pas au
courant.
C'est ainsi,
tout surpris, que nous avons vu deux soldats arriver et l'un
d'eux poser le canon de sa mitraillette sur le ventre du
contremaître en lui demandant des explications au sujet du lait.
Enfin tout
se termina bien les femmes eurent leur lait comme d'habitude.
Vers la fin
février,
un détachement de l'armée battant en retraite vint cantonner à
la ferme pendant deux jours. A leur départ, ils embarquèrent mes
deux meilleurs chevaux ainsi que le plus gros cochon.
Pour
l'armée, le patron faisait figure de déserteur qui avait
abandonné sa ferme. Le patron dut être prévenu car il revint
dans la nuit mais c'était trop tard.
Et ce fut le
projet du troisième départ. Il demanda à Jules de l'emmener,
qu'il partirait le premier, et le reste de la ferme suivrait le
lendemain. Jules ne voulut pas l'emmener.
Alors voyant
que les choses allaient tourner au tragique, que ça finirait
mal, je devais me dévouer. A contre cœur, j'allais donc voir le
patron et lui dit .
" Alors,
vous voulez partir ",
" oui ",
" et
Jules ne veut pas vous emmener",
" non ",
" et
bien, je vous emmène, mais à condition ",
" Quelles
conditions ? "
" je veux
un camarade avec moi ",
" Vous
n'êtes plus un gamin Anton " me dit-il.
" Non, je
ne suis plus un gamin mais je ne veux pas m'embarquer seul parmi
les allemands ".
"
D'accord, prenez celui que vous voudrez ".
C'est ainsi
qu'avec Milo, tous deux montés aux quatre vents sur la calèche
-et la famille Weilland à l'intérieur- que nous quittâmes la
ferme pour de bon.
Première
escale à 60 kilomètres où les autres nous rejoignirent. Nous
avions tout juste rentré nos chevaux dans une écurie que les
Russes vinrent bombarder la ville.
Là, je me
pose la question ; si parfois on est pas débile ?
En effet, pendant le bombardement avec Milo, nous étions plantés
à la porte de l'écurie et regardions en riant évoluer ces
avions, en nous disant : " qu'est-ce qu'ils leurs mettent ! "
Alors que
sur la place à 40 mètres de nous, derrière le mur se trouvaient
des morts et des blessés.
Le char du
Pasteur de notre région fut écrasé par les bombes. Mon patron me
demanda si je voulais prendre un autre char et aller chercher
son matériel. Avec Milo nous allâmes récupérer ce qui était
valable, tout se passa bien pour nous.
Mais sur la route, c'était la vraie débandade, l'armée allemande
battait en retraite.
Une drôle
d'armée allemande, c'était un détachement de l'armée
Charlemagne. C'est-à-dire des volontaires Français engagés dans
l'armée allemande. J'ai reconnu un sous-officier qui avait été
prisonnier à Mulhouse avec moi.
Il disait à
un de ses gars qui n'avait plus que ses chevaux " qu'est-ce
que tu as fait de tes pièces ? "
" Elles
sont restées dans le ravin, les allemands m'ont laissé tomber ".
Pour nous, ce n'était pas des Français, c'étaient des ennemis,
au même titre que les chleus.
Déjà quelques temps avant, je livrais un chargement de grain,
j'en avais rencontré trois qui sortaient d'un bistrot. Ils
avaient crié " bonjour, ça va "
"
oui
vous parlez bien Français vous ",
" mais
nous sommes français ".
"Vous
êtes français ? Dans cette tenue chleu, vous n'avez pas honte,
vous venez finir de nous enfoncer ".
Moi voyant
sortir un gradé allemand, je me suis barré avant qu'il soit trop
tard.
Si Hitler
avait enrôlé de force les Alsaciens, leurs cœurs étaient restés
français, j'en avais eu la preuve souvent lorsque je traversais
le terrain militaire pour aller au camp. Sans se faire voir ils
me le disaient.
Tandis que les volontaires, c'est qu'ils avaient fini de bien
faire en France et au lieu d'aller en prison, ils s'engageaient
là-dedans.
Le lendemain
4 Mars,
nous partons pour une autre étape. Nous arrivons dans une grosse
ferme, plus grosse que la nôtre puisque plus de vingt
prisonniers sont encore là.
Maintenant,
nous sommes trois, Quittet est venu nous rejoindre. Nous n'avons
pas de peine à loger nos chevaux, les écuries étant vides et le
foin ne manque pas. Après avoir mangé, nous nous réfugions tous
les trois dans une petite maison ouvrière vide aussi.
Lorsque vers onze heures, je me réveille en sursaut, et je dis
aux copains " levez-vous vite, la maison brûle ". Ce
n'était pas la maison, c'étaient les Russes qui attaquaient la
ville de Bad-Poltzin (où nous étions le matin).
Un vrai
déluge avec ces chars ces bombes, ces obus et les mitrailleuses.
Je compare Bad-Poltzin à Montbrison et nous à Chante-perdrix.
Bien placés pour voir.
Ne sachant
pas ce qui pourrait arriver, nous allâmes nous réfugier dans le
commando chez les autres prisonniers.
Le 5
mars,
quand le jour se leva, le paysage était blanc de neige, plus de
bruit de canon, ni de mitrailleuse, mais pas de Russes. Ils
s'étaient emparés de la ville et arrêté leur progression à un
kilomètre de notre hameau.
Puis à 13
Heures arriva une patrouille de deux polonais, avec leurs
mitraillettes très gentils avec nous, ils nous demandèrent si on
voulait la mitraillette, s'ils nous avaient fait des misères, si
on avait des comptes à régler. Toutes les réponses furent
négatives. Par contre la sentinelle fut emmenée comme
prisonnier.
Un autre
soldat fut blessé dans le château (c'était le moins qui puisse
arriver). Puis ils réintégrèrent leurs lignes en nous disant :
" Français, préparez-vous, dans une heure ou deux, nous
serons de retour et vous pourrez partir ".
En effet une heure et demie plus tard, un détachement Russe
était là.
Ils nous ont
dit : " Français, sauvez-vous vite, les Allemands risquent de
contre-attaquer ".
Sans
attendre, nous traversons les lignes Russes. Tous ces soldats en
ligne dans les champs, à plat ventre dans un trou, avec les
mottes devant leur tête, pour se garantir des balles, le cas
échéant.
En traversant la ville qu'ils avaient prise la nuit précédente,
nous avons eu la preuve, en voyant tout le matériel militaire
allemand déposé sur la place, qu'ils s'étaient rendus (les
allemands) - J'ai ramené un bidon militaire allemand - Nous
avons marché jusqu'à minuit, fatigués, nous avons dormi dans un
abri au bord de la route, le sol était recouvert de vitres
cassées.
Qu'importe,
on a dormi. Dès le jour, nous continuons notre marche en
direction de Neustettin où nous arrivons à midi, le ventre
creux, plus âme qui vive dans les rues.
Quittet doit se débrouiller pour trouver quelque chose à manger.
Pendant ce temps, Milo et moi, nous devons trouver trois vélos
pour continuer la route en direction de l'Hôpital du camp,
peut-être y trouverons-nous des ordres ou directives pour nous
aider à rentrer en France.
Dans cette ville que je connais bien, nous revenons une heure
plus tard avec Milo poussant nos trois vélos.
Dans une
cave Quittet a trouvé un grand bocal de choux-fleur, ainsi
qu'une bouteille de vin.
Quel banquet
!
Quittet m'a dit : " Dans un étage plus haut, il y a deux
personnes très âgées qui ont peur ".
Et bien, je vais aller les voir, ce que je fis. Timidement ils
m'ouvrirent leur porte.
Je leur dis
: " N'ayez pas peur, nous sommes des Français, nous ne vous
ferons pas de mal, nous allons coucher ici cette nuit, et nous
partirons demain matin ".
Cinq minutes plus tard, ce pépé nous a apporté un morceau de
pain en nous disant
" c'est
tout ce qui me reste ".
Quelle bonne nuit, pour la première fois depuis longtemps.
Le
lendemain, réveillé de bonne heure, je voulus aller voir aux
abattoirs s'il ne restait rien.
Quelle surprise !
Il faut que
les Allemands soient pressés pour laisser un tel stock de
saucissons longs et gros comme un bras...
Je m'en suis chargé une bonne brassée.
Sur le chemin du retour, je rencontre une patrouille Russe. En
les apercevant j'en menais pas large, mais contrairement à ce
que je pensais, en voyant mon chargement ils ont éclaté de rire
et ne m'ont pas inquiété.
J'arrive donc où nous avions élu domicile pour la nuit, Quittet,
Milo et moi prenons ce qu'il nous faut comme saucissons et je
porte le reste à ces deux pépé et même je leur dis qu'il y avait
aussi de grandes cuves pleines de graisse, s'ils voulaient me
donner un grand plat, j'irai leur en chercher, ce que je fis.
Je leur ramenais une grande bassine de graisse et encore
quelques saucisses. Je leur dis : "vous mangerez ça en pensant
aux Français" Ils ne savaient pas comment me remercier. J'étais
content, je savais que j'avais fait deux heureux, (leurs yeux me
l'ont prouvé)
Puis, nous avons pris la route à nouveau, direction l'hôpital du
camp. Nous y arrivons à la tombée de la nuit, exténués. Il y a
encore beaucoup de P.G Français, et en particulier le
responsable de l'Hôpital, mon copain, le sergent Brunon, qui a
fait son service militaire avec moi à Saint-Etienne et qui
s'était occupé de moi lors de mon accident (à Tannberg).
A notre arrivée, il est surpris de me voir encore là, et me
demande tout de suite si nous avons faim.
Comment dire
NON !
Piquant dans ses réserves, il sort un bout de viande à chacun
que nous avalons rapidement et tout de suite nous nous
renversons dans nos lits superposés, en pensant à nos familles
qui doivent se demander ce que nous sommes devenus, voilà
bientôt un an que les nouvelles sont interrompues...
Minuit, voilà que mon Brunon vient me tirer par les pieds, il
est accompagné d'un soldat Russe armé.
Une colonne
de prisonniers allemands vient d'arriver. "Ils sont dans une
baraque" me dit-il. Les sentinelles Russes sont très fatiguées ;
tous les trois vous ne voudriez pas aller les garder le restant
de la nuit pendant qu'elles se reposent. Je ne pouvais pas
refuser. Je lui dit :"nous sommes volontaires, mais il nous faut
un flingue".
Le Russe était content, il nous aurait bien donné à chacun
quatre fusils. Bien sûr, j'avais nullement l'intention de m'en
servir.
On ne garde pas une colonne de prisonniers avec les mains dans
les poches, ça serait risquer sa peau. Quelle drôle de colonne !
Je crois que les plus jeunes devaient avoir 15 ans et les plus
âgés entre 70 et 75 ans, pauvres éclopés.
C'était la
dernière réserve, L'ersatztruppen. Je ne sais pas s'il y eut des
évadés, mais nous étions quand même contents de voir que les
rôles étaient renversés et que dans le même camp, c'étaient les
allemands qui étaient à notre place. Quelle humiliation pour
eux. Le lendemain un officier Russe demanda un volontaire pour
l'aider, une journée seulement.
Je partis avec lui, surpris par sa gentillesse et son savoir. Il
parlait très bien l'allemand et connaissait l'histoire de France
mieux que moi, nous parlions comme deux frères de la France, de
la Russie. Il n'y avait plus de galons, ni de frontière ? entre
nous ; comme j'avais trouvé ça beau... Notre travail consistait
après avoir mangé car il avait insisté (d'abord manger, après le
travail) à charger sur des camions des tonneaux d'essence ainsi
que des cuves vides qui partaient plus près du front former un
nouveau dépôt.
J'avais passé une bonne journée en ami. Une rumeur circulait au
sujet des bateaux à Odessa qui partaient pour la France.
Ne sachant
pas combien de temps durerait encore la guerre une colonne se
décida à partir pour Odessa sans autre moyen de transport que
les jambes. De la Baltique à la mer Noire, il y a de quoi user
ses souliers et le moral. Notre colonne est donc partie en
direction de Bromberg, avec étape à Hanriesch Wald Firchau,
zempelburg, Bromberg. Les uns poussant une poussette chargée de
quelques vêtements ou affaires personnelles, d'autres un vélo
avec un peu de bagage et d'autres sac au dos.
Nous arrivâmes
le 20 Mars
à Bromberg. Il fallut attendre jusqu'au
4 Mai
pour avoir un train ; les voies ferrées les ponts, tout était
démoli.
Le 4
Mai
enfin, nous partions pour Odessa. Ce fut une erreur car quatre
jours plus tard c'était l'Armistice et en passant par
l'Allemagne et la Tchécoslovaquie nous serions sans doute
rentrés en France plus tôt.
Lorsque sonna l'armistice, nous étions à Lublin en Pologne. Le
conducteur du train nous emmena à une dizaine de kilomètres de
la ville, près d'un champ de patates qui venaient d'être semées
et décrocha sa locomotive et s'en alla.
Pendant cinq jours, nous ne vîmes personne, par contre, il ne
resta plus une pomme de terre dans le champ.
Au bout de
cinq jours le chauffeur et sa loco réapparurent, la loco fut
accrochée et le train repartit.
Galkau,
Radom, Deblin; Jaroslaw, Lamber, Tarnapol, Odessa le
19 Mai
nous
arrivions à Lunsdorf, banlieue d'Odessa.
Nous étions
logés, certains dans des granges, tous les trois nous étions
dans une petite maison vide, couchant à même le plancher car il
n'y avait pas de paille, mais c'est une question d'habitude.
Cinquante mètres nous séparaient de la mer. La nourriture se
composait de blé, ou du millet cuit dans des grandes chaudières,
sans doute y avait-il un peu de sel et un brin de graisse car
pour moi qui n'était pas délicat, c'était mangeable.
Pendant deux jours, j'avais été volontaire pour aller travailler
dans une vigne. Deux camions venaient nous chercher chaque matin
à raison d'une trentaine debout dans chaque camion.
De cette vigne, je n'en ai vu que l'entrée, de tout côté je n'ai
pas vu de limites, je ne saurai en donner davantage de détails.
A midi, on nous apportait la soupe du camp et pour notre journée
nous avions notre litre de vin blanc en partant. J'ai vu
l'entrée de la cave, avec ses très larges escaliers pour y
descendre et ses parois carrelées, tels les sous-terrains de la
gare de Pérache. Mais je n'en ai pas vu l'intérieur. L' Ukraine
est un pays extraordinaire avec ses champs de blé, d'orge, de
vignes à perte de vue.
Pour les moissons, vous voyiez une demi-douzaine de
moissonneuses batteuses, l'une derrière l'autre. A l'école,
j'avais appris que l'Ukraine était le grenier de l'Europe je
pense que c'est vrai. Mais il faut ajouter que ces grandes
surfaces agricoles ne sont pas des propriétés privées. Ce sont
des Kolkos, des propriétés de l'Etat Russe. Les ouvriers sont
plus pauvres que chez nous, ils vivent dans des petites cabanes
avec le feu dans un trou creusé dans le talus, et les ustensiles
de cuisine pendus à un arbre devant la porte. Si nos Français
qui se plaignent toujours y faisaient un petit stage, peut-être
seraient-ils contents de revenir en France.
Un jour que tous les trois : Quittet, Milo et moi avions envie
de café, nous avons projeté d'aller glaner de l'orge dans le
champ voisin. En peu de temps, nous avons ramassé un bol de
grains ; vite un petit feu entre deux cailloux, une tôle dessus
et voilà l'orge qui grille. Il grille tellement qu'il prend feu,
c'était plus que du charbon, quelle importance, il nous
noircissait l'eau, c'était bon, c'était du café.
Une fois
nous sommes passés dans un champ de courges, elles étaient
petites et pas encore mures, nous en avons piqué chacun une,
puis calés derrière un talus, nous avons mordu dedans. Je ne
sais pas si c'est poison, mais pour ma part, j'ai été vraiment
malade.
A
Odessa,
j'ai passé aussi quelques jours vraiment malade, je croyais y
laisser ma peau, j'ai du aller chez le docteur. Et comme le
docteur, c'était une doctoresse militaire Russe qui s'occupa de
moi, elle me guérit avec des ventouses, (médicament bon marché),
je lui dois mes remerciements.
A Odessa nous n'étions pas plus en sûreté qu'ailleurs. Il y
avait des mines partout le long de la mer.
Le lendemain
de notre arrivée, nous étions tous contents de nous mettre à
l'eau et nous débarbouiller, mais voilà qu'un gars marche sur
une mine bien camouflée dans le sable. Ne me demandez pas le
résultat. Seuls restaient la tête et le thorax vide. Plus de
jambe, ni bras, ni ventre, tout avait disparu.
Dans le mois de Juillet, Madame Catroux (femme du Général) nous
rendit visite. A la hâte j'écrivis une lettre à Maria qu'elle
eut la gentillesse d'emporter en France. C'était la première
fois depuis mai 1944 que je donnais de mes nouvelles.
Je crois que sa visite, servit notre cause, en accélérant les
préparatifs pour notre retour. Quelques jours plus tard un train
de P.G partit pour la France, dont Jean Marie Gourbeyre de
Courreau qui se chargea de porter.une lettre à Maria.
C'est à
Odessa que j'ai fait la connaissance de notre ami Jean Blanc de
Valcivières.
Enfin,
le 2 Août
1945,
jour de mon 31ème anniversaire, j'embarquais pour mon retour en
France, dans un wagon à bestiaux. A l'intérieur et à mi-hauteur
de chaque wagon il y avait un plancher, ce qui nous obligeait à
y entrer courbés, par contre nous étions moins gênés, car au
lieu de 80 hommes selon le règlement il y en avait 40 dessus et
40 dessous. C'était aussi la bonne saison et dans la journée il
y en avait qui montaient sur les wagons, le voyage ne fut pas
rapide.
20 jours
d'Odessa jusqu'à Strasbourg. Souvent la voie n'était pas libre,
des ponts à réparer et même le convoi était trop lourd selon la
locomotive (il n'était pas rare dans les virages où il faut
davantage de force, faute d'élan, que la loco patine) Il fallait
reculer, reprendre de l'élan.
Parfois
comme à Rutnau, en haute Silésie, nous restâmes deux jours
attendant que la voie soit réparée.
Pour la
nourriture, c'était autre chose, après avoir perçu chacun un
colis de 3 kg au départ, et une soupe qui nous fut servie à
travers un soupirail de cave en passant à Katowice
(Haute-Silésie), après, plus rien.
Tous les 4 ou 5 jours, le train s'arrêtait où il y avait un
champ de patates, aussi bien en Pologne qu'en Allemagne, chacun
bondissait du train essayant de faire le plein.
Lorsque la musette contenait quelques kilos de ces tubercules
crus, nous étions sauvés. Pour l'eau c'était le même procédé,
les fontaines étaient prises d'assaut, nous prenions patience
car nous rentrions à la maison. Pourtant, c'était le silence,
personne ne chantait. Chacun pensait, depuis si longtemps sans
nouvelle, ce qu'il allait trouver en rentrant.
Certains
savaient que toute leur famille avait été tué et la maison
écrasée (Dieppe) ; d'autres que leurs femmes avaient quitté le
foyer, où autre...
Nous avions le temps de voir le pays.
Cracovie
(Pologne) qui paraissait si beau. Breslau tout brûlé, il ne
restait que des murs calcinés et des cheminées encore debout.
Cotbus avec ses rails tordues. Dresden avec ses wagons projetés
sur les ruines des maisons à 30 mètres de la voie ferrée, il
restait seulement quelques clochers éventrés, les rues n'étaient
plus visibles, seul restaient des ruines. Ils nous ont parlé de
200 000 morts en vingt minutes.
Très croyable en voyant les ruines de cette ville.
A Munich, la croix rouge grecque nous a donné une cigarette à
chacun, s'excusant de ne pouvoir faire mieux. Nous n'étions pas
attendus.
Enfin, nous passâmes le pont de Kehl la nuit. A la pointe du
jour nous étions à Strasbourg...
Quel drôle
d'effet d'entendre parler français avant d'ouvrir le wagon. A
Strasbourg, nous avons été très bien reçus, un bon repas et je
me souviens qu'il y avait un verre de vin. Après avoir vécu des
jours avec des pommes de terre crues, nous savions l'apprécier.
Un grand merci à Strasbourg. Le soir, nous quittons Strasbourg
pour aller à Paris Je n'ai jamais compris pourquoi, sans doute
c'était plus rapide qu'en passant par Mulhouse, Besançon, Lyon
et Saint-Etienne
Je suis donc arrivé
le 24 Août
1945
dans l'après-midi à Montbrison où ma femme et mes deux enfants
m'attendaient ainsi que Vincent Joandel, chargé de me monter à
Sauvain.
Quelle
émotion ! de quoi en tomber cardiaque. Que les enfants ont
grandi. Maria est comme moi, nous avons de la peine à articuler
quelques mots, nous ne pouvons exprimer ce que nous ressentons.
Personnellement, je crois que je rêvais, je me souviens tout
juste de Vincent, le maire de Sauvain qui était venu me
chercher.
Je me suis
pourtant réveillé en arrivant au dessous du Roure, face à
Sauvain, lorsque j'ai entendu les cloches qui sonnaient à toutes
volées.
Je me
demandais ce qui arrivait. Maria et Vincent m'ont dit : "c'est
pour toi qu'elles sonnent, pour fêter ton arrivée". Je me serais
bien passé de tant d'honneur, j'avais hâte de rentrer à la
maison et de me reposer un peu. Vincent nous conduisit donc
jusqu'à Sauvain. Ce fut encore ma plus grande surprise quand je
vis tous les gens de la commune rassemblés, le Père Trapeau en
tête qui m'acclamait et chacun voulut m'embrasser. Sauvain fit
la fête toute la nuit. J'étais le dernier des P.G.
Malheureusement, je ne reconnaissais plus les jeunes après six
ans d'absence.
Un de mes frères qui avait 10 ans à mon départ en avait 16 à mon
retour. C'était un homme, je ne l'ai pas reconnu !.
Un vin d'honneur nous fut servi dans la maison Néel qui avait
été le centre d'accueil de tous les P.G de Sauvain.
Après ce vin d'honneur Vincent nous emmena au Crozet tous les
quatre, Maria les deux enfants et moi.
Je ne
remercierai jamais assez Vincent et toute la population de
Sauvain pour l'accueil chaleureux qu'ils m'avaient réservé.
A Sauvain la
fête fut grandiose, le bal dura toute la nuit : le dernier des
Prisonniers était rentré.
Antoine
MASSACRIER